|
Introduction au dossier
Léo Coutellec, Sebastian J. Moser, Hartmut Rosa
Du mariage paradoxal entre sensibilité et insensibilité
Nous sommes en temps de crise, une crise indissociablement écologique et sociale dont il n’est pas question de documenter ici la nature ou de discuter la portée. Les diagnostics ont été faits (Devictor, 2015 ; Rockström et coll., 2009), les signaux d’alerte largement popularisés (Carson, 1962 ; Vargas, 2019). Et plus en avant, une question ne cesse de nous hanter : ne sommes-nous pas obligés de constater une grande insensibilité collective à la destruction du vivant et à l’injustice sociale ? Ou, situation plus trouble, constater un mariage paradoxal entre une sensibilité croissante d’une part – sensibilité écologique ainsi que sensibilité à l’injustice raciale et sexiste – et, dans le même temps, une insensibilité croissante à ces phénomènes dans la « vie factuelle » s’exprimant dans des actes et choix sociétaux qui aggravent aussi bien la crise écologique que sociale ? Sinon, comment expliquer que l’urgence de la question écologique reste à ce jour sans véritable réponse politique internationale à la hauteur des enjeux ? Sinon, comment expliquer que la migration – au lieu d’être reconnue comme une conséquence de la perte des espaces vitaux, d’une inégalité croissante ainsi que des guerres politico-religieuses – renforce les positions nationalistes et le repli sur soi ?
L’invisibilité médiatique ou informationnelle de ces phénomènes – destruction du vivant et injustice sociale – ne peut pas en être une raison acceptable à l’heure d’un accès sans précédent à l’information et d’une médiatisation croissante. Le manque d’analyse ou de compréhension à leur égard ne sont pas non plus de bons candidats pour expliquer cette insensibilité. Au contraire, il semblerait que l’espace des raisons soit largement mobilisé pour aider à décrypter, à analyser les causes et les effets de ces phénomènes. Sur le seul sujet du réchauffement climatique, nous en avons un bon exemple avec le travail de long cours du giec (2019). Reste la possibilité que l’inaction, le désintérêt ou l’insensibilité face à la destruction du vivant et à l’injustice sociale soient le fruit d’un choix éthique et politique, à savoir une pesée et un arbitrage de valeurs et de finalités. Effectivement, la défense de certaines valeurs, comme le profit économique, le confort, l’abondance matérielle ou, pour le dire autrement, l’extension de notre capacité de nous approprier le monde, d’utiliser la nature en la rendant maîtrisable en tout lieu et en tout point, pourraient prévaloir sur la création d’un mode de relation en résonance (Rosa, 2018 ; 2020). Mais alors, qu’en est-il de ceux pour qui cette aspiration à une relation au monde moins destructrice, plus résonante, reste une valeur primordiale, au point d’en faire un projet politique, mais qui pourtant n’agissent pas concrètement, ou trop peu, face à la destruction du vivant, n’incarnent pas ou trop peu au travers de tous leurs sens la colère d’une destruction de ces valeurs ? Ou, pour le dire autrement : pourquoi, comme nous le montrent de nombreuses recherches empiriques, ceux qui accordent une grande importance à la durabilité sont aussi ceux qui ont la pire empreinte carbone (Kennedy et coll., 2015 ; Moser et Kleinhückelkotten, 2018) ?
La sensibilité : un vecteur d’engagement à l’action ?
Comme l’information, comme le savoir, les valeurs ne semblent pas être en soi des principes directeurs de l’action. L’hypothèse que nous souhaitons formuler est la suivante : l’accès et la circulation de l’information, la construction et la diffusion des savoirs, l’affirmation et la défense de valeurs ne suffisent pas à tisser une relation avec le monde, ne suffisent pas à produire des axes de résonances qui nous engagent individuellement et collectivement à agir, lorsqu’ils sont vidés de leur dimension sensible, lorsque l’affect qui les sous-tend, ou du moins les traverse, est refoulé, inhibé, invisibilisé voire réprimandé. Or, aussi en guise d’hypothèse : être touché, atteint, ému ou animé par ce qui nous entoure est peut-être l’une des capacités indispensables pour faire face aux crises, capacité sous-déterminante de nos sphères informationnelles, de nos efforts cognitifs, de nos revendications axiologiques.
Au moins depuis le début des années 2000, la question de l’affect a attiré l’attention de plusieurs théoriciens pour dégager une autre conception de notre relation-au-monde (Massumi, 2002 ; Clough, 2008 ; Ruddick, 2010 ; Hoggett et Thompson, 2012 ; Nussbaum, 2013). Une chose exerce une puissance sur une autre, cette dernière s’en trouvant modifiée, nous dirons que l’affect est le nom de cette modification (Lordon, 2016). L’affect, l’affectus de Spinoza, est ainsi cette capacité à affecter et à être affecté. Plus précisément, l’affect décrit l’émoi émotionnel et physique de l’attention du sujet ; c’est ainsi « qu’il développe un intérêt intrinsèque pour le fragment de monde qui lui fait face et se sent […] en position de destinataire » (Rosa, 2020, p. 43). Cette interpellation ne peut pas être neutre, sans valeur ou sans signification.
Les récentes catastrophes sanitaires comme la pandémie du sars‑cov‑2 ou écologiques comme les inondations estivales en Europe de l’Ouest, compris comme événements qui nous arrivent et nous frappent, nous montrent comment cette disposition affective peut s’imposer à nous, nous laisser sans défense aussi bien au sens littéral qu’au sens figuratif. Victime d’un méga-feu, d’une violence effroyable, nous ne perdons pas uniquement nos biens matériels, la fumée âcre et la chaleur torride nous touchent dans notre chair, dans nos corps (Zask, 2019). L’événement catastrophique peut nous affecter au travers de tous nos sens. Il en sera de même pour ces populations contraintes de quitter leur logis, leur village, leur région suite à la montée des eaux, de ces peuples indigènes chassés par la déforestation, de ces familles dépendantes de l’aide alimentaire dans des villes où l’abondance matérielle et la sur-consommation sont devenues ostentatoires. En ces temps de crise, l’étendue de notre surface d’affection augmente considérablement.
Mais alors de nouvelles questions embarrassantes émergent : faut-il être touché individuellement par la catastrophe pour être touché par ses effets collectifs, ses effets sur autrui ? Faut-il vivre l’injustice dans son existence pour la combattre au-delà ? « Être touché » ne serait-ce alors qu’une disposition passive alimentant les thèses en vogue qui consistent à souhaiter l’effondrement pour qu’enfin le sursaut civilisationnel se produise ? C’est une voie possible mais dont certaines limites ont déjà été diversement documentées (Larrère et Larrère, 2020). Cette position qui consiste à dire « tant qu’on n’a pas les pieds dans l’eau, on ne bouge pas » est caractéristique d’une certaine façon de comprendre la place et le rôle des affects. Elle cantonne ces derniers à des dispositions passives et individuelles. L’affect est réduit à ce que l’on reçoit passivement, en tant que sujet. Pourtant, nous pouvons comprendre que « tout est affaire de figurations intenses puisque ce sont ces images, ces visions qui, bien plus que tout autre discours abstrait sur la cause, déterminent à épouser la cause » (Lordon, 2016, p. 65). Ainsi, pourrait-on faire de l’affection une contagion, non angoissante mais mobilisante, créer des « machines affectantes » dont le but n’est pas de nous contraindre devant la certitude d’une catastrophe mais de nourrir notre puissance d’agir avec et face à celle-ci.
Reformulons ainsi ce que nous explorons dans ce dossier : la disposition à être touché, la survenue de l’affect dans notre façon d’agir ou de réagir face à la destruction du vivant et/ou à l’injustice sociale peut aussi être une disposition active et non spécifiquement individuelle. Une disposition à cultiver et à encastrer dans l’information, le savoir, l’éthique. Comment l’information peut-elle être autre chose qu’une entreprise de production de subjectivités contemporaines aliénées ? La science, et plus généralement la démarche cognitive, peut-elle être comprises autrement que comme une démarche insensible de désensibilisation (Dumain et coll., 2013) ? Comment les valeurs éthiques que nous défendons peuvent-elles entrer en résonance avec nos corps, traverser tous nos sens ? Comment peuvent-elles résonner aussi au travers de corps sociaux, de nos institutions dont les logiques guident nos actions quotidiennes et qui sont insensibles ou « muettes » face à ces valeurs ? Autrement dit, comment installer concrètement l’idée que l’affect est une forme de lien social et politique ?
Pour aller au cœur de la problématique que nous interrogeons dans ce dossier, nous posons la question suivante : comment peut-on caractériser, documenter, valoriser un lien entre l’affect et l’action qui ne soit pas uniquement le résultat passif d’une situation contrainte ou qui réduit l’affect à une forme de sensiblerie inoffensive ? « Être touché », plus qu’une injonction au changement individuel ou la disposition passive à espérer, pourrait être à la fois une disposition à cultiver collectivement et une méthode pour l’action. Sans avoir les pieds dans l’eau peut-on être activement et collectivement affecté par la crise écologique ? Sans avoir la faim au ventre, peut-on être activement et collectivement affecté par la montée indécente des inégalités sociales ? Peut-on être activement et collectivement affecté au point de nous engager vers et avec l’autre non plus seulement avec des slogans ou des valeurs, mais véritablement corps et âme, en résonance ? C’est donc la construction d’un horizon éthique, épistémologique et politique des affects en temps de crise que les contributions de ce dossier cherchent à construire.
 Lire l’article entier sur Cairn (en libre accès) Lire l’article entier sur Cairn (en libre accès)
|
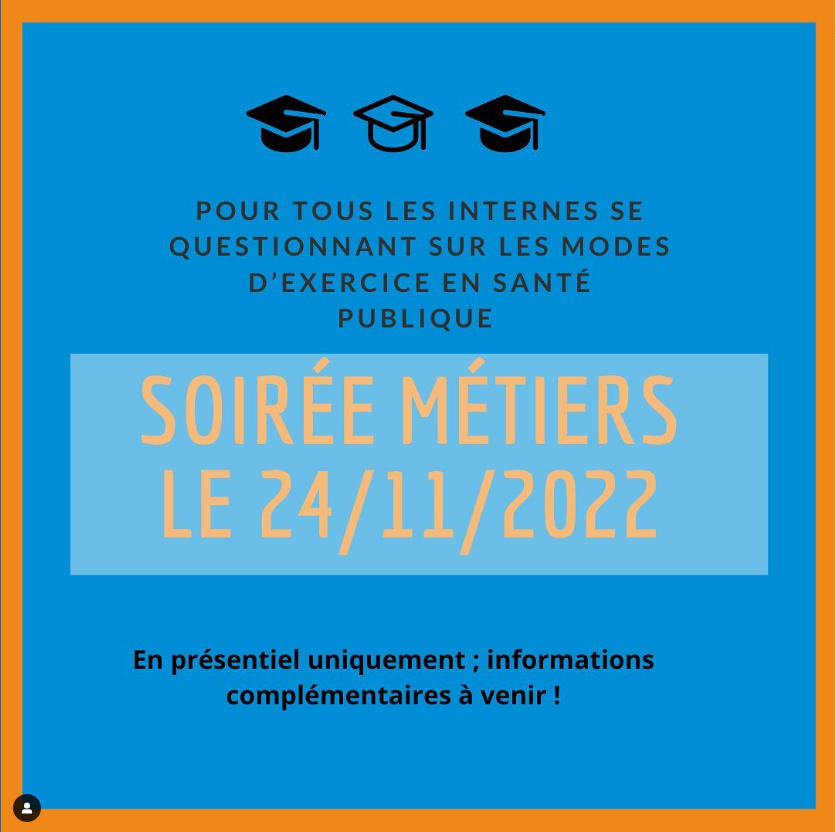






 Commander la revue en service presse :
Commander la revue en service presse : 



